Risque & Progrès : L’équation délétère se met en place avec l’affaire du sang contaminé (11/12)
A une époque où les risques de mortalité n’ont jamais été aussi faibles dans les sociétés occidentales et la maîtrise des enjeux technologiques aussi élevée, c’est pourtant un tenace sentiment d’insécurité qui prédomine et taraude les esprits. Hier fruit du hasard, de la fatalité ou de la volonté divine, la catastrophe ne cesse aujourd’hui de rôder et de potentiellement sourdre à tout moment comme le résultat de l’impéritie des hommes à contrôler des progrès qui étaient pourtant censés être les piliers infaillibles d’un monde meilleur.
L’Homme a certes vécu de tout temps sous le joug de peurs existentielles récurrentes d’autant que la consistance même de sa vie a longtemps été réduite à bien peu de choses. Sans cesse menacé par des épidémies et des famines ravageuses, des catastrophes naturelles insurmontables ou des guerres sanglantes, l’être humain traversait son existence en se percevant très vite comme un macchabée en devenir à plus ou moins brève échéance. Si l’on mourait plus au Moyen-âge, on désespérait en revanche nettement moins qu’aujourd’hui !
En France, un scandale a particulièrement marqué la société au point de la faire basculer dans une équation délétère dont le modèle systémique perdure encore aujourd’hui à chaque crise ou convulsion sociétale. Ce scandale est la célèbre affaire du sang contaminé. Avec lui et ses cinq mécanismes récurrents, la société s’est durablement plongé dans une ambiance anxiogène à l’égard des technologies et des industries. Retour sur un événement marquant de la systémique de crise moderne.
Le temps des révélations a sonné
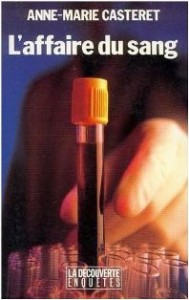
Au terme d’une longue enquête, la journaliste Anne-Marie Casteret révèle le scandale du sang contaminé en 1991
Le 25 avril 1991, après un long et tenace travail d’investigation, la journaliste Anne-Marie Casteret publie dans l’hebdomadaire L’Evénement du Jeudi, un scoop dont elle est loin d’imaginer l’impact que celui-ci va imprimer durablement dans la société française. La révélation consiste en une note du Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) en date du 29 mai 1985. Sa lecture révèle clairement que le directeur général du CNTS, le docteur Michel Garetta, a laissé en toute connaissance de cause, se poursuivre la distribution de lots sanguins contaminés par le virus du SIDA auprès d’hémophiles sous traitement.
L’ensemble des médias français s’empare aussitôt du dossier. Les éléments accablants s’accumulent à vitesse éclair. Sous la pression, le Dr Garetta démissionne en juin 1991 tandis qu’une enquête administrative est diligentée suite aux faits dénoncés. Les conclusions mettent en lumière les négligences mortelles commises par plusieurs hauts responsables administratifs et politiques du système français de santé entre 1982 et 1985. Négligences qui conduiront à la contamination d’environ 8000 transfusés (dont une majorité d’hémophiles) par le virus du SIDA.
Le scandale du sang contaminé peut véritablement être considéré comme le modèle fondateur de la systémique de crise en France. L’équation délétère qui l’anime est celle que l’on va inexorablement retrouver à l’origine des crises sanitaires et industrielles ultérieures qui émaillent la société française jusqu’à nos jours. Une équation délétère qui fonctionne sur la combinaison de 5 facteurs.
Facteur n°1 : L’incertitude scientifique comme toile de fond
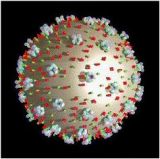
Le virus du SIDA bouscule la connaissance scientifique
L’histoire du sang contaminée survient à un moment où le virus du SIDA a été identifié quelques années plus tôt. Si les voies de transmission sont très vite cernées (le sang et le sperme en l’occurrence), ce nouveau rétrovirus pathogène demeure en revanche une énigme scientifique. Les médecins assistent impuissants à la mort de leurs patients tandis que la nouvelle maladie virale sème la confusion dans leurs certitudes médicales en se montrant rebelle aux thérapeutiques les plus éprouvées.
En parallèle, il s’établit subrepticement une vision simplificatrice avec laquelle la pathologie est rapidement qualifiée de « cancer gay » dans les médias, une partie du corps médical et les conversations quotidiennes. L’association systématique entre SIDA et homosexualité est d’autant plus renforcée que la communauté gay paie en effet un lourd tribut à la maladie. De plus, les homosexuels eux-mêmes vont très vite se structurer en associations de patients pour alerter et faire pression sur le corps médical, les responsables politiques, les médias, les autorités sanitaires et les laboratoires pharmaceutiques afin d’accélérer la recherche thérapeutique et améliorer la prise en charge des malades.

L’obélisque de la Concorde recouvert par Act Up en 1993
C’est notamment l’avènement de la plus médiatique et virulente d’entre elles : Act Up. Créée en 1987 à New York, l’association ne recule devant rien pour faire entendre la cause des malades. Extrêmement revendicative et fortement connotée homosexuelle (même si elle défend aussi les toxicomanes, les sans-papiers ou les prostituées), ses combats font du bruit. Ses militants mènent des actions éclair spectaculaires qu’ils dénomment « zaps » comme recouvrir l’obélisque de la place de la Concorde d’un préservatif géant en décembre 1993 ou asperger de peinture rouge sang la façade du siège francilien d’une entreprise pharmaceutique suisse en novembre 2001.
Les actions choc sont largement relayées par les télévisions mais parallèlement elles ancrent un peu plus les préjugés autour du SIDA dans l’opinion publique. Le raccourci du « cancer gay » trouve ainsi matière à perdurer en dépit des observations scientifiques qui démontrent rapidement que la maladie n’est pas l’apanage exclusif des homosexuels. Pour l’opinion publique, cette maladie si ravageuse soit-elle ne la concerne pas. Le 1er facteur de l’équation délétère est en place. Autant dire que l’affaire du sang contaminée va constituer une secousse tellurique majeure en frappant des personnes autres que les gays !
Facteur n°2 : La rétention d’information comme réaction première

A l’époque, Le Centre National de Transfusion Sanguine est confronté à des pénuries récurrentes de sang
Dans ce contexte médiatico-médical mouvant autour du SIDA où le sang se trouve être l’un des vecteurs de contamination, le système de transfusion sanguine se retrouve de fait en première ligne. Le moins qu’on puisse dire est que cette agitation tombe plutôt mal. Le Centre National de Transfusion Sanguine est confronté à des pénuries récurrentes de sang à cause du faible nombre de donneurs mais également parce qu’il s’appuie sur un mode opératoire de collecte rigoureux pour ne pas recourir à des importations de concentrés sanguins issus d’autres pays.
Ainsi pour chaque groupe sanguin identifié, les dons de sang recueillis chez les volontaires sont poolés (les sangs prélevés chez plusieurs donneurs d’un même rhésus sanguin sont mélangés ensemble) de manière à obtenir des quantités suffisantes de poches sanguines. Cela permet de faire face en temps normal aux situations médicales requérant des transfusions en n’importe quel point du territoire français.
L’heure est donc cruciale pour le CNTS. Depuis 1983, l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré le SIDA comme « problème de santé publique internationale ». Informé de la situation qui est en train de virer à l’épidémie massive aux Etats-Unis, Jacques Roux, directeur général de la Santé, diffuse alors le 20 juin 1983 une circulaire à tous les médecins transfuseurs (1) : « Bien que la transfusion sanguine ne constitue actuellement qu’un risque minime de transmission du sida, le caractère grave de cette affection et l’absence de test approprié pour la détection des éventuels porteurs de son agent pathogène conduisent le secrétariat d’Etat chargé de la Santé à recommander les mesures suivantes aux médecins des établissements de transfusion sanguine ». Ces mesures invitent par conséquent à sélectionner plus drastiquement les donneurs en leur faisant remplir un questionnaire de santé détaillé et permettre ainsi d’exclure des personnes potentiellement à risque.

Un rapport confidentiel suggère que la contamination pourrait déjà avoir affecté le dispositif transfusionnel français
A première vue, l’initiative laisse pourtant perplexe. Pourquoi en effet lancer un avertissement d’une telle envergure si la transfusion sanguine ne représente qu’un risque « minime » comme l’énonce la circulaire ? Tout simplement parce que Jacques Roux est en possession d’un second dossier autrement plus explosif : un rapport ultra-secret (2) émanant d’un médecin du CNTS et remis au ministère de la Santé. Il révèle qu’en France, 6 hémophiles sont déjà atteints. Or, trois d’entre eux ont été transfusés avec des concentrés sanguins d’origine française. Un indice troublant qui laisse suspecter que la contamination pourrait déjà avoir affecté le dispositif transfusionnel français. Malgré tout, l’information va être passée sous silence. Pire (3), elle n’est même pas relayée dans la revue spécialisée, La Gazette de la Transfusion que lisent les médecins des 180 centres régionaux de transfusion sanguine.
Le résultat ne se fait guère attendre. Neuf mois plus tard, cette même revue publie un sondage sur les pratiques médicales des transfuseurs suite à la circulaire de la direction générale de la Santé. Les commentaires sont édifiants (4). Plus de la moitié des responsables de centre déclarent n’avoir pas appliqué les consignes requises par la tutelle. 90% sont incapables de citer les quatre groupes de donneurs à risque à surveiller en priorité. Enfin, la plupart d’entre eux estime que le danger est localisé avant tout de l’autre côté de l’Atlantique et qu’en outre, les questionnaires de santé sont intrusifs et contre le respect de la vie privée de leurs donneurs. Le 2ème facteur de l’équation délétère vient de se mettre en place : une rétention d’information dans l’espoir (souvent illusoire) de ne pas propager la crise qui couve.
Facteur n°3 : L’irresponsabilité technique entre en jeu

La revue médicale The Lancet annonce une nouvelle découverte sur le SIDA plus grave qu’escomptée initialement
Le 22 décembre 1984, la prestigieuse revue médicale internationale, The Lancet, jette un pavé dans la mare en écrivant (5) : « Selon les dernières observations, les anticorps secrétés par un sujet séropositif pour lutter contre le virus ne semblent pas jouer leur rôle protecteur ». En d’autres termes, le « porteur sain » séropositif considéré jusqu’alors comme « auto-vacciné » et protégé de la maladie, constitue en fait et au contraire le premier stade déclaré du SIDA. La contamination est donc effective dès que le rétrovirus du SIDA a pénétré l’organisme et même si la période d’incubation peut s’étaler jusqu’à plusieurs années avant d’attaquer les cellules immunitaires de l’individu jusqu’au stade ultime et fatal de la maladie.
Autre découverte : le SIDA est particulièrement contagieux. A la différence d’autres pathologies où l’infection ne se déclare qu’une fois, la surcontamination est possible avec le SIDA. Ce qui accroît encore plus vite la charge virale du malade comme son niveau d’infectiosité en cas de transmission par le sang ou le sperme. Année après année, les chiffres de cas déclarés de séropositivité ne cessent d’ailleurs de s’orienter à la hausse. Fin 1984, la France en recense plus de 200 et estime à environ 30 000, le nombre de personnes séropositives.
Jean-Baptiste Brunet, médecin épidémiologiste au ministère de la Santé, remet alors à Jacques Roux, une note alarmante. D’après des enquêtes ponctuelles menées avec des tests expérimentaux de dépistage dans quelques centres parisiens de transfusion, 6 donneurs sur 1000 seraient séropositifs. Il s’avère également que la voie transfusionnelle a un pouvoir contagieux énorme : un donneur atteint du SIDA a contaminé 7 receveurs tandis qu’un autre donneur séropositif a infecté 11 personnes. Le médecin inquiet écrit explicitement le 12 mars 1985 (6) : « La transfusion est un mode de transmission efficace de l’infection par le virus. Si ces enquêtes sont représentatives de la région parisienne, alors tous les produits sanguins préparés à partir de pools de donneurs parisiens sont actuellement contaminés ». A la lecture de ces lignes, le directeur général de la Santé se contente simplement de parapher le document d’un simple « Vu ». Aucune décision de retrait des lots sanguins suspectés, ni d’instauration de tests de dépistage obligatoire pour les dons ne sont prises.

La question du chauffage des concentrés sanguins se pose alors
Au même moment, un autre dossier épineux préoccupe les autorités sanitaires françaises : le recours ou pas au chauffage des concentrés sanguins qui sont administrés aux hémophiles. La question se pose avec d’autant plus d’acuité que la Fondation nationale américaine des hémophiles recommande déjà officiellement depuis 1983 de chauffer les produits destinés aux hémophiles pour inactiver le virus du SIDA qui est particulièrement fragile à la chaleur. En France, un rapport du même Jean-Baptiste Brunet confirme l’efficacité de cette méthode pour décontaminer les poches de sang infectées.
En 1984, un procédé de chauffage est même mis au point par le centre de transfusion de Lille mais le CNTS choisit de ne pas l’appliquer dans l’immédiat. Les produits non-chauffés continuent par conséquent d’être distribués jusqu’en juillet 1985 où le chauffage devient alors obligatoire. Cette fois, c’est le 3ème facteur de l’équation délétère qui se met en branle avec l’irresponsabilité technique et managériale des décisionnaires qui laissent la situation perdurer en l’état.
Facteur n°4 : L’argument économique comme unique boussole décisionnaire

Les co-découvreurs du virus du SIDA : les professeurs Montagnier (à gauche) et Gallo (photo AFP)
L’immobilisme de ceux qui sont aux commandes du système de santé s’inscrit en outre dans le cadre d’une sourde rivalité scientifico-économique qui oppose deux sommités médicales. En 1983, l’équipe de l’Institut Pasteur dirigée par le professeur Luc Montagnier est la première à isoler le nouveau rétrovirus. Elle s’empresse de publier sa découverte dans la très réputée revue scientifique internationale Science mais faute de jouir d’une notoriété médicale établie au niveau mondial, l’avancée du professeur français passe quasiment inaperçue sauf auprès d’un confrère virologue américain, le professeur Robert Gallo.
Celui-ci demande à son homologue tricolore, une souche du virus afin de pouvoir l’étudier à son tour. Le professeur Montagnier accède à sa requête tout en poursuivant ses propres travaux sur la mise au point de tests de dépistage pour les personnes susceptibles d’être contaminées par le SIDA. En parallèle, il prend d’ailleurs soin de déposer une demande de brevet d’antériorité aux Etats-Unis. L’enjeu n’est pas anodin. En protégeant son invention, il peut espérer toucher des royalties sur n’importe quel autre test fabriqué ultérieurement. Sa demande demeure sans réponse de la part des autorités américaines compétentes.
Or, en avril 1984, c’est le coup de théâtre. Devant les caméras du monde entier, Margaret Heckler, secrétaire d’Etat à la Santé des Etats-Unis, annonce fièrement que le professeur Gallo vient de découvrir le rétrovirus responsable du SIDA. En France, c’est la soupe à la grimace. L’équipe de l’Institut Pasteur s’estime injustement flouée par celle du professeur Gallo d’autant que le laboratoire Abbott qui soutient ce dernier, a également considérablement progressé dans la fabrication de ses tests de dépistage.
Une course commerciale va alors s’engager entre les deux protagonistes et leurs labos respectifs sur fond de querelle patriotique. Dès mars 1985, le test américain est opérationnel et aussitôt mis en vente aux Etats-Unis. Abbott s’empresse de demander une homologation aux autorités sanitaires françaises pour que le test soit également disponible en France. C’est sans compter l’obstruction forcenée de son concurrent hexagonal. L’Institut Pasteur a en effet pris du retard dans le développement de ses propres tests. Pour continuer de rivaliser avec Abbott, l’entreprise française n’hésite pas à faire pression sur les décisionnaires politiques pour retarder au maximum l’enregistrement des tests concurrents et gagner ainsi un peu de temps pour investir en premier le marché français.

Les tests de dépistage font l’objet d’une course commerciale acharnée qui retarde la mise sur le marché
Fin avril 1985, Robert Netter, directeur du Laboratoire national de la Santé en charge des homologations, fait part de ses inquiétudes grandissantes à Edmond Hervé, secrétaire d’Etat à la Santé (7) : « Il ne me paraît pas possible dans les circonstances actuelles de surseoir plus longtemps à l’enregistrement des tests Abbott sans risquer un recours en Conseil d’Etat pour abus de pouvoir ». La question fait alors débat au plus niveau de l’Etat. Pourtant, le cabinet du Premier Ministre, Laurent Fabius, demande le 9 mai que le « dossier d’enregistrement du test Abbott soit encore retenu quelque temps au Laboratoire national de la Santé » (8) en soulignant que le test de Pasteur risque sinon d’être « complètement exclu du marché si aucune disposition n’est prise pour le protéger » (9).
A la presse, à certains médecins et aux associations de malades qui s’interrogent et s’agacent de plus en plus des manœuvres dilatoires autour de la mise sur le marché des tests et l’application du dépistage obligatoire, les autorités répliquent que l’évaluation des tests n’est pas encore bouclée et la fiabilité du dépistage non assurée tout en minimisant le risque sanitaire.
Autre décision prise dans la foulée par les autorités politiques et sanitaires : continuer à écouler les stocks existants de sang d’autant que ceux-ci représentent une charge financière non négligeable évaluée à 34 millions de francs par les responsables du CNTS. Le 4ème facteur de l’équation délétère s’est enclenché à son tour avec une analyse exclusivement économique au détriment de l’urgence sanitaire qui exigeait la diffusion rapide des tests de dépistage et l’arrêt de la circulation des stocks sanguins suspectés.
Facteur n°5 : L’incurie des décideurs politiques

Les responsables gouvernementaux vont faire preuve d’attentisme exagéré dans la gestion du dossier
Dans son enquête sur l’affaire du sang contaminé, Anne-Marie Casteret a mis en relief à de nombreuses reprises les multiples tergiversations et ralentissements dont les autorités politiques ont fait preuve au fur et à mesure que le dossier devenait de plus en plus épineux. Malgré les alertes répétées des services sanitaires et les preuves épidémiologiques qui indiquaient la détérioration progressive de la situation, les cabinets de Laurent Fabius, Premier Ministre, Georgina Dufoix, ministre des Affaires Sociales et Edmond Hervé, secrétaire d’Etat à la Santé, ne vont cesser de régulièrement fluctuer.
Le 9 mai 1985, une réunion interministérielle se déroule dans les bureaux du Premier Ministre. L’instauration du dépistage obligatoire pour les dons de sang est à l’ordre du jour. Un conseiller d’Edmond Hervé, déclare (10) : « Les cas de SIDA transfusionnel sont somme toute assez rares. La généralisation du test n’aurait aucun effet de freinage sur la maladie puisque seulement quelques cas seront évités ». La discussion digresse alors sur les risques commerciaux encourus par le test Pasteur par rapport à son concurrent américain. Le conseiller scientifique du Premier Ministre envoie en conclusion une note où il minimise le risque sanitaire tout en conseillant de surseoir encore quelque temps à l’enregistrement du test d’Abbott.
Le récit d’Anne-Marie Casteret continue sur le même registre (11). Le 22 mai 1985, Edmond Hervé s’apprête à annoncer officiellement le dépistage systématique au cours d’un congrès sur la transfusion. Le conseiller scientifique du Premier Ministre l’en dissuade, voulant réserver la primeur de l’annonce à Laurent Fabius, hiérarchie gouvernementale oblige. Toutefois la pression médiatique devenant intenable, le Premier Ministre se décide enfin à accélérer la cadence. Devant l’Assemblée Nationale, il annonce le 19 juin la mise en place du dépistage obligatoire. Le test Pasteur est aussitôt mis en vente tandis que celui d’Abbott doit continuer à faire antichambre administrative pendant un mois supplémentaire dans l’attente de son homologation.

Les décrets d’application tardent à entrer en vigueur et retardent la mise en place du dépistage
C’est sans compter cependant avec la lenteur du processus administratif. Lequel, en l’absence de date d’application du décret, tarde à instaurer le dépistage et à débloquer les fonds nécessaires pour financer la mise en place dans les centres de transfusion. Le professeur Jean Ducos qui conseille le secrétariat d’Etat à la Santé, s’alarme du manque de réactivité. Il écrit aux responsables ministériels le 27 juin (12) : « Je suis très préoccupé par la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons placés. Nous savons en effet que chaque jour nous injectons des produits sanguins provenant de donneurs séropositifs qui provoqueront une séroconversion chez le receveur. (…) Je crains également les conséquences juridiques de ce que l’on pourrait appeler notre carence collective ».
Ce n’est que le 1er août 1985 que le dépistage obligatoire entre enfin en vigueur. Dans son article de L’Express, Anne-Marie Casteret cite en conclusion la réponse de Jean-Baptiste Brunet interrogé par un juriste du ministère de la Santé sur les conséquences de ce déploiement tardif (13) : « Deux mois de retard : 400 à 500 morts sur la conscience ». Le 5ème facteur de l’équation délétère est désormais dans la boucle.
Le modèle de la crise contemporaine est désormais en place

Georgina Dufoix : « Responsable mais pas coupable »
Le scandale du sang contaminé constitue véritablement le modèle fondateur de la systémique de crise en France à travers les 5 facteurs de l’équation délétère décrite ci-dessus. C’est celle-ci qui articule désormais toutes les crises majeures que rencontre la société française.
Avec la révélation brutale de l’affaire du sang contaminé, la société s’interroge. Elle se voit soudainement confrontée à sa propre vulnérabilité. La peur va dès lors irriguer les pores d’une confiance sociale ébréchée. L’exigence du risque zéro et la logique d’affrontement vont vite devenir les points cardinaux d’une société déboussolée par l’ampleur d’un tel scandale et l’incurie des acteurs de la chaîne décisionnaire. Chacun garde encore en mémoire la phrase lapidaire malencontreuse de Georgina Dufoix, ministre des Affaires Sociales, qui admettra lors d’une interview télévisée (14) « se sentir coupable mais nullement responsable ».
Aujourd’hui, la confiance sociale est rompue au profit d’un délire sécuritaire tous azimuts et son corollaire intrinsèque : une implacable logique d’affrontement qui débouche sur la recherche effrénée de bouc émissaire. Une dualité crispée d’autant plus inévitable que l’affaire du sang contaminé a vu justement naître de nouveaux acteurs au profil nettement plus offensif et revendicatif. Là où auparavant, la société civile subissait plus ou moins passivement les catastrophes, des groupes s’organisent. Ils n’hésitent plus à mener avec acharnement les luttes qu’ils estiment nécessaires. De cette dualité nouvelle, découle une judiciarisation croissante qui est devenue à l’heure actuelle une constante absolue des crises. Une judiciarisation où la recherche effrénée du coupable parvient même à occulter la pourtant nécessaire remise à plat des dysfonctionnements ayant mené à la crise.
Quand les crises se règlent au tribunal

L’heure du procès pour trois des accusés du dossier du sang contaminé dont le Dr Garetta (à gauche)
Dans le cas du sang contaminé, les docteurs Michel Garetta, directeur général du CNTS et Jean-Pierre Allain, chef du département de recherche du CNTS, sont lourdement sanctionnés pour tromperie en juillet 1993. Le premier écope de 4 ans de prison ferme, le second de 4 ans dont 2 avec sursis. D’autres responsables administratifs sont également condamnés sévèrement comme Jacques Roux, directeur général de la Santé qui prend 4 ans avec sursis. Robert Netter, le directeur du laboratoire de la Santé, est quant à lui relaxé.
L’émotion est tellement considérable dans le public que le dossier a même pris une coloration politique. En décembre 1992, le Parlement décide de la mise en accusation des ex-responsables socialistes, Laurent Fabius, Edmond Hervé et Georgina Dufoix devant la Haute Cour de Justice de la République française pour manquements commis lors des responsabilités qu’ils exerçaient entre 1984 et 1985. C’est la première fois que des ministres doivent ainsi rendre compte de leurs actes dans le cadre d’une crise sanitaire. Seul Edmond Hervé est au final condamné mais dispensé toutefois de peine au motif qu’il a été « soumis avant jugement à des appréciations souvent excessives ». Les deux autres ministres obtiennent quant à eux la relaxe. Peu de temps après, un autre ancien ministre de la Santé en la personne de Claude Evin sera à son tour mis en examen avant d’obtenir un non-lieu définitif en 2003. Le « volet ministériel » de l’affaire du sang contaminé est clos.
Parallèlement au procès des politiques, l’instruction judiciaire concernant les responsables administratifs connaît aussi de nouveaux développements. En juillet 1994, un juge d’instruction lance de nouvelles poursuites pour empoisonnement contre 32 prévenus dont des membres de cabinets ministériels, des médecins du CNTS et à nouveau le docteur Michel Garetta. Quatre ans plus tard, la Cour de Cassation met un coup de frein à l’instruction en statuant que la transmission consciente du virus du SIDA ne peut constituer un crime que si une volonté de tuer est prouvée de la part de l’auteur. Le commentaire fait du bruit et les associations de victimes montent alors aussitôt au créneau en déposant une nouvelle plainte pour « non révélation de crime et non assistance à personne en danger ».
L’instruction est finalement bouclée en 1999. Les pourvois et les renvois des différents protagonistes à divers niveaux judiciaires se multiplient pour aboutir en juin 2003 au point d’orgue final de l’affaire. La Cour de cassation rend un non-lieu à l’encontre des 32 prévenus pour « absence d’infraction ». Le dossier est définitivement clos.
Pour les familles des victimes, l’indignation atteint son comble. Interrogé par les journalistes, Maître François Honorat, l’un des avocats des familles, ne cache pas son écœurement (15) : « C’est un point final cynique. (…) C’est une faillite de la justice qui aura traîné pendant 11 ans les parties civiles dans les dédales d’un Palais de justice pour leur dire finalement qu’un dossier constitué de 130 tomes (…) ne mérite même pas d’être examiné ».
Conclusion : Une société à fleur de peau face au Risque et au Progrès

La société civile exige désormais l’inatteignable : le risque zéro
Le sentiment d’iniquité généré par les conclusions judiciaires a solidement installé l’équation délétère de la crise au cœur de la société française. Convulsives et récurrentes, les crises qui vont suivre vont ancrer encore plus les différents protagonistes du corps social dans leurs visions séquentielles et leurs logiques d’affrontement. Les uns vont exiger des autres de fournir des réponses à tout sans jamais relâcher la pression et quitte à faire preuve parfois de versatilité tandis que les autres vont s’efforcer de se protéger des premiers, quitte à faire de la surenchère cosmétique, apparaître comme des héros de la crise et déplacer ou repousser les véritables problèmes de fond aux calendes grecques. Le brouhaha crisique s’est encore vérifié en 2010 lorsque la pandémie du virus H1N1 menaçait.
Le 20ème siècle comme le début du 21ème ont nettement cabossé les croyances optimistes des Lumières où le salut futur de l’Homme passait nécessairement par la science, les innovations et les progrès technologiques, le tout contrôlé par un Etat garant d’une société juste, morale et protectrice. Si les risques ont été effectivement globalement éradiqués, d’autres sont apparus plus sournois et plus complexes.
L’Etat lui-même s’est fourvoyé en ne sachant pas toujours réagir de manière appropriée pour faire accepter le risque, en n’apportant pas systématiquement les réponses sécuritaires qu’on exigeait de lui ou au contraire en sur-réagissant à l’excès. Pire parfois, il a couvert d’un silence coupable, certaines dérives ou certains accidents au nom de l’intérêt économique, industriel ou national.
La science aurait pu incarner une alternative rassurante. Elle est capable d’analyser, de décortiquer, d’extraire « la substantifique moelle » comme disait François Rabelais, de comprendre un phénomène, de tirer des conclusions et d’effectuer des découvertes. A mesure que les progrès se multipliaient, la science s’est toujours penchée sur la connaissance des risques. Toutes les grandes catastrophes du monde moderne ont été passées au crible pour les expliquer et les comprendre. Souvent, il en a découlé des améliorations substantielles dans la gestion et la prévention des risques. Mais s’il est possible de deviner avec précision l’occurrence statistique d’un risque, la science n’a pas réussi à réduire l’incertitude inévitable et intrinsèque aux découvertes, lever certaines zones d’ombre, ni à atteindre la cible du mythique et fallacieux « risque zéro ».

Conséquence de l’équation délétère : la justice s’empare de plus en plus des crises
Or, la société actuelle cultive une sensibilité de plus en plus à fleur de peau envers le risque. Les directeurs de conscience qu’ont été en leur temps l’Eglise puis l’Etat pour expliquer et prendre en charge le risque, n’ont plus la légitimité qui leur fut autrefois accordée. Les experts eux-mêmes sont sévèrement remis en cause. Le risque n’est plus tolérable aux yeux du plus grand nombre. Un étrange paradoxe alors que les dangers réels n’ont jamais été aussi réduits que de nos jours.
Conséquence de cette confiance rompue : la justice prend une importance croissante pour compenser les dégâts causés aux victimes. Outre des directives de plus en plus drastiques en matière sécurité industrielle, le droit consacre l’indemnisation des victimes. C’est quelque part la résurgence inconsciente de la victime expiatoire pour réparer les dommages commis. Puisque les technologies nous dépassent, que les moyens de sécurité sont inefficaces, il faut pouvoir désigner malgré tout un coupable comme pour expier l’injustice des morts, des malades et des blessés. Dans l’opinion publique, il n’y a plus de risques sans coupable. On en revient quasiment à l’attitude de la ville de Thèbes qui bannissait Œdipe sur-le-champ pour avoir provoqué l’ire des dieux.
Aujourd’hui, le risque est sorti du champ exclusivement technique et scientifique pour aller à celui du social. L’enjeu actuel consiste donc à prendre en charge le risque, à le reconnaître, à l’évaluer au mieux, à l’accepter comme partie intégrante de notre vie et comme contrepartie des activités que nous menons. Dirigeants politiques, experts scientifiques et entreprises doivent absolument intégrer cette notion au lieu de continuer à cacher la poussière sous le tapis ou au contraire à s’agiter excessivement pour montrer qu’on agit.
Sources
(1) – Anne-Marie Casteret – « Mortelles négligences » – L’Express – 4 février 1999
(2), (3), (4) – Ibid.
(5) – The Lancet – 22 décembre 1984
(6) – Anne-Marie Casteret – « Mortelles négligences » – L’Express – 4 février 1999
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) – Ibid
(14) – TF1 – Sept sur Sept – Novembre 1991
(15) – Reportage de Cécile Mimaut et Jean-Baptiste Vieille – France Info – 18 juin 2003
Pour en savoir plus
– Lire le livre d’Anne-Marie Casteret intitulé L’affaire du sang (Éditions La Découverte – 1992)
– La fiche biographique d’Anne-Marie Casteret sur Wikipedia
– Lire l’article de Philippe Froguel et Catherine Smadja – «Les dessous de l’affaire du sang contaminé » – Le Monde Diplomatique – Février 1999
– Sur les crises sanitaires, lire le blog spécialisé de l’agence conseil en communication de crise Antaria Consultants
Lire les précédents articles du dossier « Risque & Progrès »
– « Pourquoi est-on en crise ? » (1/12) – 15 mai 2010
– « Le mythe, le divin et le bouc émissaire comme antidotes » (2/12) – 21 mai 2010
– « La désacralisation est en route » (3/12) – 29 mai 2010
– « Le grand écart entre Science et Sacré se poursuit » (4/12) – 2 juin 2010
– « Le mythe Progrès gagne des points » (5/12) – 14 juin 2010
– « Quand un mythe chasse l’autre » (6/12) – 2 juillet 2010
– « Premières lézardes dans la confiance » (7/12) – 8 juillet 2010
– « La confiance s’ébrèche au cours du 20ème siècle » (8/12) – 20 août 2010
– « L’effet papillon est parmi nous » (9/12) – 30 août 2010
– « Quand la manipulation entre en jeu » (10/12) – 9 septembre 2010

















2 commentaires sur “Risque & Progrès : L’équation délétère se met en place avec l’affaire du sang contaminé (11/12)”-

-

Merci ! La question posée est pertinente et cruciale. Il y a des risques que l’on sait modéliser et « prédire » statistiquement. Les assurances sont notamment expertes en la matière. Ensuite, il y a les risques qu’on connaît et qu’on sait accepter parce que le ratio bénéfice/risque est bon. En d’autres termes, on sait qu’un risque peut impacter mais on est prêt à la prendre car les bénéfices sont énormes. C’est le cas du médicament par exemple. On sait que des effets secondaires sont possibles mais on sait aussi que des vies sont sauvées malgré ces effets.
Enfin, il y a le risque « inconnu » notamment avec les nouvelles technos dont il est aujourd’hui impossible de prédire le risque exact. Au départ, c’était d’ailleurs l’objectif du principe de précaution. On encadre et on corrige à mesure que la connaissance évolue mais on laisse le progrès avancer. Depuis, son essence a été largement dévoyée. Il est devenu un principe bloquant qu’on invoque quasi systématiquement dès que l’ « illusoire » risque zéro ne peut être atteint. Il est aujourd’hui appliqué comme principe de sécurité. On ne sait pas donc on interdit ou on punit.
Pour les politiques et les décideurs en général, c’est effectivement ultra-complexe. Ceux-ci doivent décider dans un contexte évolutif et en n’ayant pas forcément tous les paramètres en main. Avec en plus l’omniprésence médiatique et l’exigence de l’opinion publique qui exige d’un côté et qui veut sanctionner de l’autre en cas de manquement. Du coup, on assiste souvent dans cette équation infernale à des décideurs qui ne prennent plus aucun risque même si c’est en dépit du bon sens. On dégaine une loi, on désigne un coupable (généralement la grosse entreprise !), on s’agite, on en fait beaucoup pour montrer au final qu’on gère le problème et qu’on n’est pas dans l’esquive ou l’équation délétère dont on vient de parler dans l’article ! Bon désolé j’ai été un peu long mais le sujet est si vaste !
Billet passionnant et très complet, comme toujours! Mais comment reconnaître et évaluer un risque qui devient impossible à déterminer précisément? Question délicate pour les politiques confrontés au rythme rapide de l’évolution technologique dont on maîtrise de plus en plus mal l’effet à long terme sur la santé.
Les commentaires sont clos.